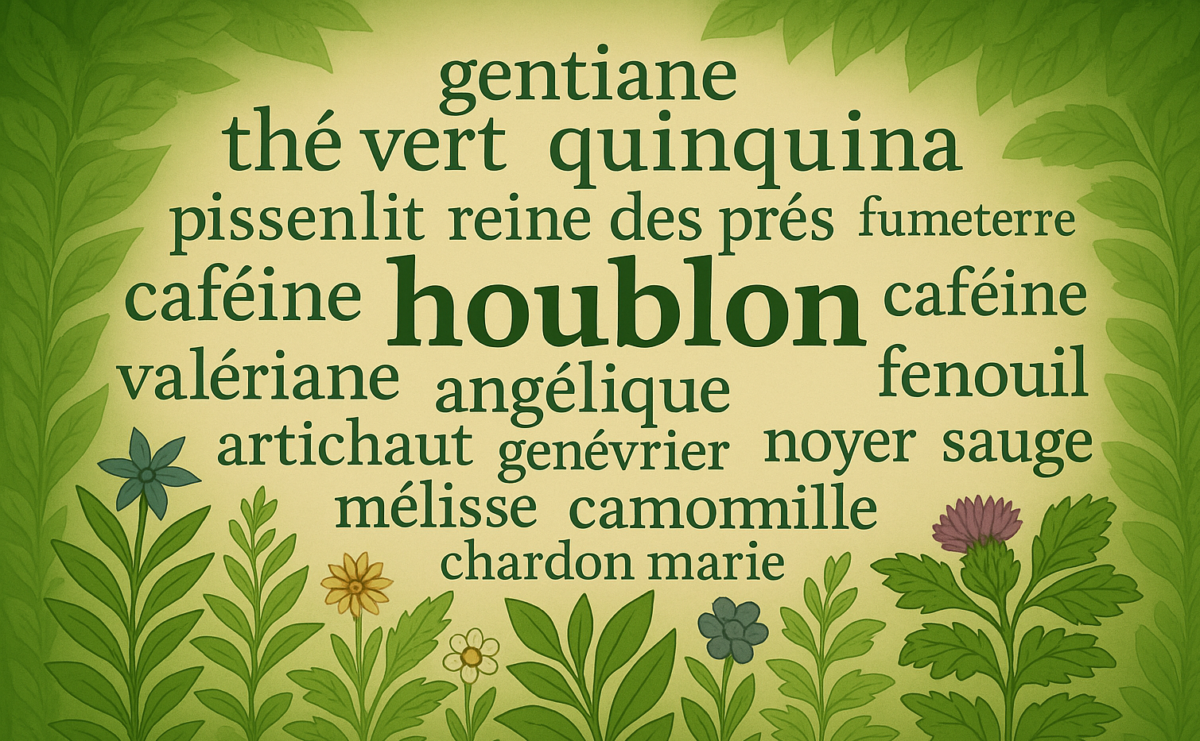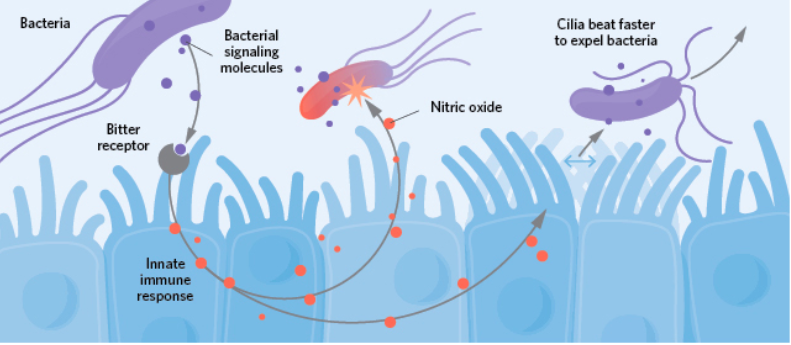En phytothérapie, dont l’amérothérapie est une branche rationnelle, les allégations médicales sont exclues: si l’on avance que telle plante peut soigner telle maladie, elle devient un médicament, et il faut alors des études longues et coûteuses pour pouvoir la distribuer comme telle… Un agrément est cependant effectif si l’on se réfère à un usage historique, traditionnel de chaque plante, sans pour autant en désigner les effets médicaux.
C’est ainsi que la très grande majorité des plantes, ou mélanges de plantes (tisanes, gélules, sirops, lotions) se présentent non pas comme des remèdes, mais comme des substances qui “aident à …, ou bien qui sont “favorables à …) sans s’impliquer dans une intention médicale, mais aussi “selon leur usage traditionnel pour …”.
Concernant les amers, en particulier les 7 amers que j’ai sélectionnés pour créer “l’amer universel”, voici les usages traditionnels (avec leurs qualités thérapeutiques), mais ces précisions d’ordre médical ne peuvent apparaître ni sur l’étiquetage, ni sur leur mode d’utilisation.
Voici les utilisations traditionnelles (non médicales) de ces végétaux dans un cadre historique, culinaire ou culturel, sans allégation thérapeutique. Ces informations s’appuient sur des sources ethnobotaniques, des traditions populaires ou des usages ancestraux (herboristerie européenne, médecine traditionnelle chinoise, savoirs amérindiens, etc.).
1. Gentiane (Gentiana lutea)
- Tradition européenne :
- Digestif : La racine, très amère, était infusée dans des vins ou des liqueurs (comme la Suze ou l’Avèze) pour stimuler l’appétit avant les repas, selon les coutumes alpines et auvergnates.
- Tonique : Utilisée dans les “amer bitters” (comme l’Angostura), souvent associés à des rituels de convivialité ou de digestion après un repas copieux.
- Symbolique : Dans certaines régions, la gentiane était considérée comme une plante protectrice contre les mauvais sorts.
- Précautions traditionnelles : Toujours diluée (jamais pure) en raison de son amertume intense.
2. Houblon (Humulus lupulus)
- Tradition européenne :
- Bière : Utilisé depuis le Moyen Âge pour aromatiser et conserver la bière (remplaçant des plantes comme le gruit). Les moines bénédictins l’ont popularisé.
- Oreiller sédatif : Les cônes de houblon étaient glissés dans des taies d’oreiller pour favoriser un sommeil réparateur (usage populaire en Allemagne et en Angleterre).
- Cuisine : Jeunes pousses consommées comme asperges sauvages en Europe de l’Est.
- Symbolique : Associé à la fertilité et à la protection dans le folklore germanique.
3. Thé vert (Camellia sinensis)
- Tradition asiatique :
- Rituel : Au cœur de la cérémonie du thé japonaise (chanoyu), symbole d’harmonie et de respect. En Chine, offert en signe d’hospitalité.
- Cuisine : Utilisé pour parfumer des plats (ex. : thé vert salé au Japon, œufs au thé en Chine), des desserts (glaces, mochi) ou des marinades.
- Conservation : Les feuilles étaient parfois mélangées à des céréales pour éviter les moisissures (usage ancien au Vietnam).
- Variétés : Le matcha (thé vert broyé) était réservé aux samouraïs pour son effet énergisante avant les combats (légende).
- l’utilisation locale des infusettes de thé après infusion pour soigner des peaux irritées, des eczémas, voire des psoriasis) est de renommée publique.
4. Reine-des-prés (Filipendula ulmaria)
- Tradition européenne :
- Boire des druides : Appelée “herbe des abeilles” (fleurs mellifères), elle était infusée dans des hydromels ou des vins aromatiques.
- Parfum : Utilisée pour parfumer les liqueurs (ex. : Chartreuse) ou les vins (comme le vin de mai alsacien).
- Cuisine : Fleurs séchées pour aromatiser des desserts (crèmes, gelées) ou des salades printanières.
- Irritations cutanées: applications locales efficaces (présence active d’acide salicilique, une aspirine naturelle).
- Folklore : Associée aux fées et aux rituels de protection des maisons en Irlande.
5. Fumeterre (Fumaria officinalis)
- Tradition méditerranéenne et européenne :
- Purification : Brûlée comme encens dans les maisons pour “assainir l’air” (usage mentionné par Dioscoride).
- Tisane printanière : Consommée en infusion avec d’autres herbes (pissenlit, ortie) lors des “cures de printemps” en France et en Espagne.
- Cuisine : Jeunes pousses ajoutées aux salades en Crète ou en Turquie (goût légèrement amer et rafraîchissant).
- Symbolique : Son nom latin (Fumaria, “fumée”) évoque son usage pour chasser les mauvaises énergies.
6. Fenouil (Foeniculum vulgare)
- Tradition méditerranéenne et moyen-orientale :
- Digestif : Graines mâchées après les repas en Inde (mukhwas) ou infusées en tisane en Grèce (pour faciliter la digestion des plats gras).
- Cuisine : Bulbe consommé cru ou cuit (comme légume), graines dans les pains (ex. : focaccia italienne), les saucisses (ex. : finocchiona toscane) ou les currys.
- Rituels : Dans la Rome antique, on suspendait du fenouil aux portes pour éloigner les esprits malfaisants.
- Autres usages : Huile essentielle pour parfumer les savons (tradition marseillaise).
7. Quinquina (Cinchona spp.)
- Tradition sud-américaine :
- Boisson tonique : L’écorce de quinquina (riche en quininine) était infusée dans des vins ou des eaux-de-vie par les Jésuites au XVIIᵉ siècle pour lutter contre les “fièvres des marais” (usage historique, non médical).
- Apéritif : À l’origine des tonics (comme le Schweppes), mélangés à du gin pour masquer l’amertume (cocktail Gin Tonic né dans l’Empire britannique).
- Symbolique : Appelé “écorce des Jésuites”, car rapporté en Europe par des missionnaires.
- Précautions : L’écorce pure est très amère et était toujours diluée.
8. Stévia (Stevia rebaudiana)
- Tradition guaraní (Paraguay/Brésil) :
- Édulcorant naturel : Les feuilles étaient mâchées ou infusées pour sucrer les boissons (comme le maté) ou les aliments, bien avant la découverte du sucre raffiné.
- Rituels : Utilisée dans des cérémonies pour ses propriétés “douces et apaisantes” (selon les chamanes guaranís).
- Médicine populaire : Appelée “ka’a he’ê” (“herbe douce”) par les Amérindiens, mais sans allégation spécifique.
- Usage moderne : Cultivée au Japon depuis les années 1970 comme alternative au sucre.
L’utilisation en tisane ou en action locale de ces 7 amers permet des actions bien plus précises et effectives que ces attributions d’usages traditionnels. Mais pour rester dans le cadre juridique assez étroit de la phytothérapie, nous ne pourrons qu’évoquer ces pratiques historiques.